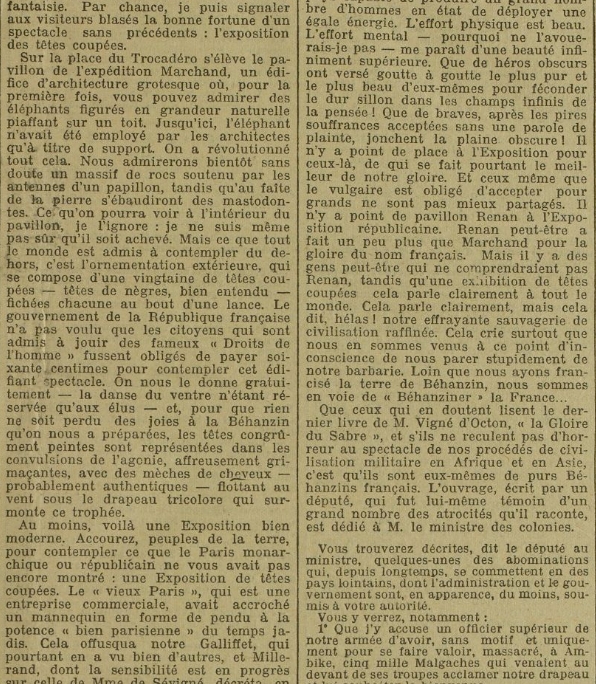LA FAUTE DE LA REPUBLIQUE
Le mouvement Black Lives Matter, né aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, a relancé la "question noire" dans les anciennes puissances européennes esclavagistes et colonialistes. Mais c'est depuis une dizaine d'années déjà que la question est soulevée officiellement en France, notamment à l'initiative du pouvoir exécutif. Le 10 mai 2006, pour la première fois, la France métropolitaine a organisé une journée nationale de la mémoire de l’esclavage et de la mémoire de l’abolition, alors que le thème de la colonisation refaisait surface, et après la création, en novembre 2005, du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) et la publication d'un grand dossier du journal La Croix (être noir en France) début 2006. Comme le soulignait alors l'anthropologue (et jésuite) Stéphane Nicaise dans "La question noire en France" (Études 2006/9): "Par le recours à l’histoire, et en particulier à l’histoire coloniale, est dénoncée l’inégalité des chances qui frappe des Français noirs par rapport à leurs concitoyens blancs aux mêmes niveaux de qualification qu’eux". La question de la colonisation en Afrique noire (et bien sûr aussi au Maghreb) n'a cessé ensuite d'inspirer de nombreux (et excellents) travaux historiques et de générer aussi des polémiques nouvelles, que le militantisme de certaines associations tout comme le discours public ont pu exacerber. Tout cela sur fond de rapports diplomatiques parfois compliqués avec les pays africains, d'une poussée de la droite identitaire et nationaliste et du développement d'un communautarisme ethnique. Exemple de polémique stérile, un alinéa qui avait été introduit dans la loi du 23 février 2005, avant d’en être retiré, voulait que «les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord». Comme sous la IIIème République d'Ernest Lavisse !
En
juillet 2007, le président Sarkozy, à peine élu, fit à Dakar un
discours qui laissa pantois les spécialistes de la civilisation
africaine et des grands royaumes africains : "Le drame de
l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans
l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec
les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature,
ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la
répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles". Cette
idée suppose en effet un degré de civilisation (histoire=civilisation
et progrès) inférieur, une sorte de Moyen-Age éternel de l’Afrique et
c’est une vision figée et surannée qui nous ramène au 19ème siècle,
même si elle se rattache volontiers à un humanisme républicain
généreux. Bref, les Européens connaissent très mal l’Afrique et
disent à peu près n’importe quoi à son sujet. Les politiques, de droite
comme de gauche, sont donc les héritiers d’une longue tradition
d’ignorance. Sans oublier un paternalisme colonial qui a été de toutes
les époques, ainsi en 1958, le général de Gaulle, toujours à Dakar,
défendait encore l’idée d’une communauté franco-africaine (contre celle
d’indépendance) et c’est papa de Gaulle qui aimait l’Afrique et les
Africains :
Je tiens à répéter à cette Afrique que j'aime l'expression de mon amitié, l'expression de ma confiance, et je suis sûr que, malgré les agitations systématiques et les malentendus organisés, la réponse du Sénégal et de l'Afrique à la question que je lui pose, au nom de la France, sera OUI, OUI, OUI ! Vive le Sénégal !
Dans le film un peu méconnu de Chris Marker et Pierre Lhomme, Le joli mai (1962, sorti début 1963), sorte d’enquête sociologique qui multiplie des interviews de Parisiens et de Parisiennes à la fin de la guerre d’Algérie (les accords d’Evian datent d’avril), on trouvait le récit d’un étudiant originaire du Dahomey (aujourd’hui Bénin et qui fut avant la colonisation et son intégration dans l’AOF un des plus grands royaumes africains). En quelques minutes, le jeune homme résumait parfaitement ce qu'était - et ce qu'allait être - la condition d'un jeune noir-africain en France dans les décennies à venir. Dans un registre comique, le très récent film Tout simplement noir tourne en dérision des clichés qui ont la vie dure depuis soixante ans, tout en stigmatisant le communautarisme "noir". Et l'acteur/réalisateur Jean-Pascal Zadi a cette formule (faussement) ironique que l'on pourrait croire dépassée en 2020 : "l'homme blanc doit comprendre que le Y'a bon Banania, c'est fini !".
.png)
Image extraite du Joli Mai
Malgré tout,
en février 2017, le candidat-président Macron a brisé un tabou, dans la
droite ligne des reconnaissances tardives d'un "passé qui ne passe pas"
(on pense au Vel d'Hiv et à Vichy). Oui, la colonisation a été un "crime
contre l'humanité" et un "acte de barbarie" et il est
temps d'oeuvrer désormais à une "réconciliation des mémoires". Et
enfin, en 2019, le même Macron a estimé que le
colonialisme a été une «faute de la République» lors
d'une conférence de presse à Abidjan en compagnie du président ivoirien
Alassane Ouattara. Réaction outrée de Mme Le Pen : "En
se vautrant dans la repentance, qui plus est à l'étranger, en ne
retenant que les aspects négatifs d'un processus complexe, Macron salit
l'histoire de France et met en danger nos soldats en Afrique, déjà
soumis à une haine anti-français croissante". Le roi des Belge
Philippe a toutefois été un peu plus loin que l'exécutif français. Le
30 juin 2020, à l’occasion du soixantième anniversaire de
l’indépendance du Congo, le roi a exprimé dans une lettre adressée au
chef de l’État et au peuple congolais des regrets pour le passé
colonial en ces termes : "A l’époque de l’État indépendant du Congo, des actes de violence et de
cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire collective.
La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances et
des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour
ces blessures du passé dont la douleur est aujourd’hui ravivée par les
discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Je continuerai
à combattre toutes les formes de racisme." Pas question
toutefois pour la Belgique de rétrocéder les biens volés au peuple
congolais du temps de la domination de Léopold II sur le Congo et du
temps de la période coloniale pendant laquelle le Congo a fait partie
de la Belgique (1908-1960) ni de déboulonner les statues de
colonisateurs et autres symboles de l’époque coloniale dans l’espace
public belge. De même en France, le président Macron s'est déclaré
opposé à tout "déboulonnage", en particulier des statues de Colbert,
tandis qu'un mouvement iconoclaste s'est manifesté dans certains
territoires, visant notamment en Martinique Victor Schoelcher,
l'abolitionniste d'avril 1848 (sous la Deuxième République, donc) qui a
aussi été député de ce territoire. Cet acte a été condamné quasi
unanimement, y compris par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
et par l'écrivain Patrick Chamoiseau, qui demande à ce que l'on
"respecte l'homme" Schoelcher. Ce qui est en jeu en réalité, c'est la
captation d'un héritage au profit de quelques "héros" (désormais ce ne
sont plus les "héros" de la colonisation comme Gallieni ou Lyautey mais
ceux de l'abolition de l'esclavage ou de la décolonisation).

Carte-postale de la statue de Schoelcher à
Fort-de-France
Comme on le voit, la controverse reste vive, mais ce qui est intéressant dans ce débat (en France) concerne la responsabilité de "La République" comme une sorte de personne morale. C'est ce que je vais tenter de clarifier dans une courte synthèse historique qui rappelle ce qu'a été l'enjeu colonial en France de 1870 (aux débuts de la IIIème République, qui a relancé la colonisation) à 1962 (la fin de la guerre d'Algérie et de notre empire colonial). Il n'y a dans ce texte aucune volonté polémique, juste un rappel à l'histoire, devenu si nécessaire dans un monde à la mémoire volatile.
Enjeu : « ce qu’on espère gagner, ce qu’on s’expose à perdre dans une entreprise »
« Un marin qui était là et qui possède des terres reprenait avec vivacité qu’on avait tort de traiter les colons de cette manière ; que sans colonie il n’y avait rien de stable ni de profitable en Afrique ; qu’il n’y avait pas de colonie sans terres et qu’en conséquence ce qu’il y avait de mieux à faire était de déposséder les tribus les plus proches pour mettre les Européens à leur place. Et moi, écoutant tristement toutes ces choses, je me demandais quel pouvait être l’avenir d’un pays livré à de pareils hommes et où aboutirait enfin cette cascade de violences et d’injustices sinon à la révolte des indigènes et à la ruine des Européens. »
Alexis de Tocqueville, Philippeville, le 30 mai 1841 (lire et relire Tocqueville!).
En 1870/71, la nouvelle République reçoit en héritage un domaine
colonial déjà conséquent : 1 million de km2, répartis sur quatre
continents et peuplés de 5 millions d’Hommes. Aux « vieilles
colonies » de l’Ancien Régime sont venus s’ajouter tout au long du
XIXème siècle, l’Algérie et le Sénégal, les comptoirs occidentaux
d’Afrique, Tahiti et la Nouvelle Calédonie, la Cochinchine et le
protectorat sur le Cambodge. Mais dans quels buts ? Pour quels
espoirs ? Avec quels enjeux ? Dans quelle mesure ces vastes
espaces sont-ils susceptibles de se trouver intégrés dans le
« retour aux questions nationales » annoncé et attendu par
Renan, alors même que le peuple français se désintéresse de
l’outre-mer ? « Colonies : s’attrister quand on en
parle » écrivait laconiquement Flaubert dans son Dictionnaire
des idées reçues.
Ces questions prennent leur sens à la lumière de l’histoire coloniale
de la IIIème puis de la IVème République. En effet, le fait
colonial fait l’objet d’un véritable débat national avant 1914 et –
paradoxalement – l’un des enjeux politiques est la conquête d’une
opinion indifférente sinon hostile. La période 1914-1939 marque
probablement l’apogée de l’Empire, ce qu’illustre l’Exposition
coloniale de Paris en 1931 : les colonies sont alors présentées
comme un enjeu majeur de la puissance française dans tous les domaines.
Mais bien des inquiétudes et des remises en cause annoncent la
difficile période qui s’ouvre avec la Seconde guerre mondiale. Après le
conflit, où l’Empire tient une place centrale, l’enjeu est désormais
celui du maintien d’une Union Française, dans le contexte de la guerre
froide et d’une « décolonisation » à l’échelle planétaire.
Enjeu international, donc, mais qui devient un drame national avec
l’Algérie, territoire qui cristallise toutes les passions coloniales de
la période 1870-1962.
.jpg)
Expo coloniale de 1931
A
quoi peuvent servir des colonies ? « L’objet des colonies, disait
Montesquieu dans L’esprit des lois est de faire le commerce dans de meilleures conditions qu’on ne le fait
avec les peuples voisins avec lesquels les avantages sont
réciproques ». Que reste t-il au début de la IIIème République de
cette conception purement mercantiliste, d’ailleurs fortement remise en
cause par les véritables Libéraux ? L’une des premières doctrines
coloniales est celle du géographe Jules Duval, pour lequel les enjeux
ne sont pas seulement liés aux échanges mais regardent l’avenir de la
planète : la colonisation représente l’exploitation, le peuplement et
le défrichement pacifiques du globe. Le but est donc humanitaire, à la
fois civilisateur au sens très large du terme et créateur de richesses.
Une autre doctrine est moins « utopique », plus réaliste et
se fonde sur des considérations géopolitiques et stratégiques
(Prévost-Paradol, par exemple) : accroître le poids de la France
dans le monde – face au Royaume-Uni et à l’Allemagne, les
véritables concurrents en matière de Weltpolitik – passe par
la fondation d’un Empire puissant, dont l’Algérie serait le pivot. La
Conférence de Berlin, en 1885, inaugure d’ailleurs une forme de
compétition à l’amiable entre les grandes puissances impérialistes. Une
troisième doctrine – par ailleurs liée aux deux premières – reprend un
vieux thème jacobin, celui d’une France « porteuse de
lumière » sinon des Lumières. Francis Garnier, le colonisateur de
la Cochinchine, l’explorateur du Mékong et le conquérant du Tonkin
définit parfaitement le nouvel enjeu colonial. L’appât du gain, la
quête du profit ne peuvent pas être les seuls mobiles de la
construction d’un Empire. La France a reçu de la Providence la mission
de l’émancipation, de l’appel à la liberté des races et peuples encore
esclaves de l’ignorance et du despotisme. Reste à peupler ces
territoires lointains, dans une France malthusienne et réfractaire à
l’émigration (si l’on excepte certains courants traditionnels, comme
celui des Basques…vers l’Amérique Latine !). Le résultat est bien
décevant : en 1890, à peine un millier de personne quittent la
Métropole pour se rendre outre-mer, sans certitude d’ailleurs de s’y
fixer durablement. Et de toute évidence, il est difficile de faire de
la colonisation pénale – en Nouvelle Calédonie, en Guyane – un
modèle de peuplement colonial pour les émigrants potentiels !
De
ce « mince point de départ » selon l’expression de Raoul
Girardet, naît une idée coloniale et impérialiste française, qui trouve
chez les géographes, les missionnaires catholiques et les républicains
opportunistes les plus ardents propagandistes, relayés par une armée en
mal d’action et d’aventures. Jules Ferry élabore dans les années 1880
une pensée coloniale autour d’une triple argumentation, d’ordre
humanitaire, d’ordre économique et d’ordre politique. Fortement
contestée à gauche comme à droite, cette doctrine peine à se répandre
dans une opinion qui reste à conquérir. Ce n’est pas le plus mince
enjeu de la colonisation dans une démocratie où les ministères tombent
aisément, notamment à propos des expéditions outre-mer (le
Tonkin !). Un Parti colonial n’est pas de trop (E. Etienne à la
Chambre, J. Siegfried au Sénat), tout comme la création de Comités (de
l’Afrique, de Madagascar, d’Océanie, du Maroc), de l’Union Coloniale
Française, pour effacer dans l’opinion l’image traditionnelle du
conquérant au profit de celle du « fondateur d’Empire »,
administrateur et bâtisseur, faiseur d’ordre et créateur de paix et
même continuateur de la mission évangélique des Eglises - le cardinal
Lavigerie, le fondateur des Pères Blancs, ne fait-il pas son appel au
ralliement en rade d’Alger ?
Les
grands regroupements territoriaux renforcent l’idée de territoires unis
: la Fédération Indochinoise, l’AOF, puis l’AEF. Gallieni, gouverneur
général de Madagascar en 1898, distingue dans ses célèbres Principes
de pacification et d’organisation les
types d’action nécessaires à la pacification. A l’action politique et
militaire succède l’action économique - dépenses publiques,
investissements privés - puis l’action civilisatrice, selon la
« méthode progressive ». Pour Gallieni, qui tire les leçons
de son expérience du Soudan et du Tonkin, il ne faut «détruire qu’à la
dernière extrémité» - lorsque l’insoumission est avérée - pour
mieux bâtir sur les ruines un village, un marché, une école. Le soldat
français - tout comme l’officier colonial - se fait alors
« surveillant de travaux, instituteur, ouvrier d’art » et
supervise les grandes campagnes de vaccination ; il est l’artisan
d’une (re)construction civilisatrice et pacifique : routes, ponts,
chemins de fer, maisons, hôpitaux ; il œuvre pour l’éradication
des traites négrières et de l’esclavage (aboli à Madagascar en 1896, au
Maroc en 1912). Une vision optimiste et humaniste qui contraste avec
les violentes caricatures d’une presse satirique antimilitariste
(l’anarchisante L’Assiette au beurre, notamment) ;
celle-ci dénonce les boucheries coloniales et montre crûment la
choquante vérité de l’animalisation et de la
« brutalisation » des indigènes (O.Le Cour Grandmaison).
C’est en Algérie que la IIIème République pense faire aboutir le rêve
colonial d’une « deuxième France », au-delà d’une simple
entreprise capitalistique. Après le grand soulèvement de Moqrabi
(1871/72), l’objectif est bien de « franciser » par le
« rattachement » (1881) tout en européanisant les terres
indigènes (loi Warnier) : plus de 5 millions d’hectares ont ainsi
été transférés à la fin du XIXème siècle. A la même période, le nombre
des Européens nés en Algérie dépasse celui des immigrés. Il paraît à
Alger en 1889 un livre populaire sur "la fusion des races européennes
d'Algérie" ; on parle de plus en plus de
« franco-algériens » voire d'Algériens tout court, avec la
loi de 1889 qui institue la naturalisation automatique des enfants
d'étranger, même si les Algériens d'origine européenne excluent de leur
communauté à la fois les Juifs et les Musulmans. Au début du XXème
siècle, la tendance est même à considérer que la forte expansion de la
population musulmane est le résultat des bienfaits de la colonisation
française, une position largement relayée par une certaine presse (les
"reportages" illustrés de Lecture pour tous, l’Almanach
du Petit Colon algérien).
En réalité, si la paupérisation de la population algérienne est
générale, surtout dans le Constantinois, les famines fréquentes (en
1887, 1893, 1897), si les « Jeunes Algériens », musulmans
francisés et laïcisés, commencent à revendiquer une stricte application
des principes républicains et la fin de l’inique régime d’indigénat, la
doctrine officielle n’évolue pas et se complait dans une image
idyllique du pays. A l'Exposition coloniale de Marseille en 1906,
l'Algérie y a cinq vastes bâtiments, avec reconstitution des
souks et d'un café maure ; on y admire les photographies du port
d’Alger, des écoles dans le bled.
Et
lorsque les frictions coloniales avec l’Angleterre (Fachoda en 1898) ou
l’Allemagne (le Maroc en 1905, en 1911) deviennent sérieuses, c’est
tout un patriotisme qui se réveille et qui ramène les
radicaux-socialistes tout comme les nationalistes aux vérités premières
de la Nation : l’Empire colonial ne constitue plus, en cas de
conflit armé, une gêne, un facteur d’affaiblissement, mais au contraire
représente un élément supplémentaire de puissance, presque un gage de
victoire. Les campagnes de Lyautey au Maroc dans les années 1912-1914
apparaissent comme autant de réussites militaires françaises, quel
qu’en soit le prix humain. Les jeunes gens de l’enquête Agathon (1913)
disent « la fierté que procure la vision d’un « planisphère
d’Afrique où de larges tâches rouges indiquent les terres où rayonne
une âme ». Les cartes de géographie de l’école républicaine ne
disent pas autre chose. Presque isolé et en tous les cas peu écouté,
Jaurès persiste à dénoncer la domination coloniale, laquelle sert
le capitalisme, empêche la modernisation de la France et accroît le
danger de guerre.
.jpg)
Avec
la Grande Guerre et l’apport des troupes coloniales – les Tirailleurs
sénégalais venus aider la « mère-patrie » alimentent le mythe
de la « Force Noire » de Mangin –, de la main d’œuvre
coloniale (du Maghreb, d’Indochine, de Madagascar), c’est la naissance
d’une conscience impériale, où l’enjeu colonial apparaît désormais plus
clair. « C’est en partie grâce à son empire colonial, affirme un
manuel scolaire en 1925, que la France a pu sortir victorieusement de
la Grande guerre, de même que l’Angleterre doit également à ses
colonies d’avoir pu mener la lutte jusqu’au bout ». Le Sénégalais
Blaise Diagne – premier député noir en 1914 - œuvre à la reconnaissance
du rôle des Tirailleurs dans la Grande Guerre. Des députés antillais
comme H.Légitimus ou G.Candace donnent corps à l’idée d’une progressive
intégration politique de l’outre-mer. Le Guadeloupéen G.Candace est
ainsi élu député (modéré) en 1911. Ministre dans les années 30 et
vice-président de la Chambre en 1938, il défend l’idée d’une mise en
valeur de la France impériale. Celle-ci sort d’ailleurs renforcée de la
guerre sur le plan territorial, avec l’ouest du Togo et le Cameroun
allemands, les « mandats » en Syrie et au Liban : le
domaine colonial est à son apogée avec 64 millions d’habitants sur plus
de 12 millions de km2.
En
1931, l’Exposition coloniale internationale est l’apothéose de
« la plus grande France » : les liens économiques se
sont renforcés (33% des exportations de la métropole, des importations
en hausse constante), les « Croisières » (noire et jaune)
suscitent l’intérêt passionné du public, la presse publie des
suppléments coloniaux et les éditeurs une littérature coloniale à
succès, les publicitaires en font un argument de vente
(« y’a bon Banania », les Cachou Négro, le cirage Bamboula),
les lignes maritimes et aériennes se multiplient, les programmes
scolaires intègrent pleinement l’histoire et la géographie de l’Empire,
avec le soutien actif de l’Union coloniale. Dans le bois de Vincennes,
c’est tout l’Empire qui est « exposé », avec en vedette la
reconstitution grandeur nature du temple d’Angkor Vat et des
« animations indigènes » très populaires. Les discours
d’unité franco-coloniale – prononcés notamment par Lyautey - vantent la
splendeur des « provinces d’outre-mer », où l’Indochine
devient la « France d’Asie » et l’Algérie le
« prolongement de la métropole ». Et l’on peut écouter
Alibert chanter Nénufar,
« Marche officielle de l’Exposition », une chanson au racisme
rigolard, tout à fait dans la veine des chansons de l’époque.
Il
existe bien, non seulement une « France de 100 millions
d’habitants », mais aussi une « vieille France
d’Europe » et une « jeune France d’outre-mer », dont les
élites fréquentent les meilleurs lycées (Senghor, Pham Duy Khiem à
Louis-le-Grand), puis les grandes écoles. L’enjeu colonial
devient celui de toute la République, à travers le discours officiel de
la « véritable grandeur de la France » (Daladier). Il demeure
aussi celui de l’Eglise catholique, confortée par les encycliques
missionnaires de 1919 et de 1926 dans la convergence entre l’idéal
missionnaire et l’idéal colonial, entre la Croix du Christ et le
drapeau national, dans une œuvre commune de « civilisation ».
Il en découle une forme de morale coloniale, fondée sur un certain
nombre de devoirs : devoir de répartition des richesses, devoir
d’éducation - l’école républicaine est ainsi exportée en Algérie pour
entreprendre la « conquête morale » des indigènes -, devoir
d’assistance et de médicalisation, qui permet de définir une
« juste colonisation ». Cette morale est aussi celle de la
paix coloniale : vouloir pousser les peuples colonisés à se
révolter est terriblement dangereux et ne mène qu’à leur
anéantissement. Et si l’indépendance est au bout du chemin, c’est le
retour à la barbarie, à la sauvagerie, au paganisme…
Derrière les beaux discours d’autosatisfaction pointe une véritable
inquiétude : c’est une autre réalité qui commence à apparaître
dans l’entre-deux-guerres, celle d’une colonisation confrontée à de
nouveaux enjeux, à de nouvelles menaces. S’agit-il des
fascismes belliqueux et expansionnistes ? Ou du Japon
impérialiste ? Pas seulement, ou pas vraiment. Le fait colonial
est d’abord fragilisé par le système d’exploitation économique ;
il est ensuite menacé par le communisme internationaliste, de nature
profondément anti-colonialiste, enfin il est directement condamné par
l’émergence des nationalismes indigènes.
La
France a toujours fondé de grands espoirs sur les ressources
coloniales, mais les colonies ont longtemps souffert d’infrastructures
insuffisantes pour valoriser ces ressources. Les progrès des
transports sont incontestables entre les deux guerres (chemins de fer,
routes, canaux, liaisons aériennes), mais la production d’outre-mer
apparaît en fin de compte plus concurrentielle que complémentaire de
celle de la Métropole (les droits de douane à l’entrée en France des
produits coloniaux ont été supprimés en 1913). Si les produits
« exotiques » ne posent aucun problème majeur (le café et le
thé d’Indochine, le tabac en Algérie) et deviennent même indispensables
à l’industrie française (le coton, le caoutchouc), trois produits
perturbent gravement le marché français : le sucre colonial, le
blé et surtout le vin, la grande richesse de l’Algérie. Les tensions
sont vives entre producteurs métropolitains et algériens, d’autant que
l’Etat refuse tout contingentement et envisage même dans les
années 1930 une « autarchie » franco-coloniale comme remède à
la crise mondiale.
L’anti-impérialisme prend – notamment au moment de la sanglante guerre
du Rif en 1925-26 – une coloration révolutionnaire, nettement
anti-capitaliste et anti-militariste. L’enjeu est nettement celui de la
libération des peuples colonisés, à travers la dénonciation des
massacres, des exactions, des abus de pouvoir, de l’exploitation
économique, sociale et culturelle. Le recours au travail forcé – ainsi
pour la construction de la liaison Congo-Océan en 1922-1934 – justifie
de telles positions. Plus nuancé peut-être dans les années 30, en
raison des menaces fascistes, le discours anti-impérialiste de
l’entre-deux-guerres se concentre surtout sur les abus de
l’exploitation coloniale, à travers notamment la littérature, les
écrits de Barbusse et surtout les livres de Gide (Voyage au
Congo et Retour du Tchad), des enquêtes journalistiques
- on pense notamment aux « Quelques notes sur l’Indochine »
publiées dans la revue Esprit par
Andrée Viollis, véritable dénonciation des méthodes coloniales au
Tonkin (1932). Certains hommes politiques ont compris la nécessité de
faire évoluer le statut des coloniaux, à défaut d’accorder l’autonomie
ou l’indépendance. L’idée d’assimilation n’est en effet pas morte. Un
leader comme Ferhat Abbas milite encore dans les années 30 pour
l’intégration des musulmans dans la citoyenneté française, avant
d’évoluer vers l’idée de séparation (le Manifeste du Peuple Algérien
date de 1943). En dépit d’un projet ambitieux, Léon Blum et M.Viollette
– un ancien gouverneur d’Algérie très critique sur l’état d’esprit
colonial - ne parviennent pas à s’appuyer sur la dynamique du Front
Populaire pour faire évoluer le droit colonial et ouvrir le
collège électoral européen à 25000 Musulmans. Que pèsent de toute façon
ces initiatives face à l’action concertée des lobbies coloniaux ?
En 1938, le ministre de l’Education Nationale Jean Zay recommande ainsi
aux professeurs d’histoire et de géographie « d’insister sur les
colonies françaises » et de respecter les programmes (« la
formation de l’Empire colonial français » y est inscrite depuis
1925).
Quant aux nationalismes indigènes, ils s’appuient non seulement sur des
principes idéologiques (le communisme de Hô Chi Minh, L’Etoile
nord-africaine de Messali Hadj, le nationalisme d’Abd-el-Krim, de
Khaled-el-Hachemi) ou politico-religieux (le panarabisme du Destour,
les Oulémas du cheikh Ben-Bâdîs), mais aussi culturels. De leur point
de vue, l’enjeu n’est pas seulement national, mais aussi racial. Le mythe du sauvage tend à s’atténuer en Occident grâce aux progrès de
l’anthropologie et de la sociologie et le mythe civilisateur s’atténue.
René Maran, fonctionnaire colonial d’origine antillaise et prix
Goncourt 1921, écrit sans détour dans son livre Batouala,
véritable roman nègre:
« Civilisation, orgueil des Européens (…) tu bâtis ton royaume sur
des cadavres. » De son côté Aimé Césaire, le brillant Normalien,
défend en 1939 une négritude que revendique aussi son
condisciple L.Sedar Senghor. On parle déjà à la veille de la guerre
d’une « communauté impériale », comme si l’enjeu était
moins celui de la domination que de l’acceptation mutuelle d’un destin
commun. Certains lancent l’idée d’un Parlement consultatif colonial,
qui ouvrirait la voie aux « Etats-Unis de France », mais la
IIIème République n’a plus le temps de réformer en profondeur ses
institutions d’outre-mer.

La
Seconde Guerre mondiale va incontestablement déplacer l’enjeu colonial
vers ce qu’on a nommé faute de mieux « décolonisation » et
qui s’apparente plutôt à un reflux impérial, par ailleurs de dimension
mondiale et pas seulement française. L’enjeu est désormais celui d’un
immense mouvement d’émancipation qui de l’Afrique à l’Asie, secoue les
peuples colonisés. La France n’est évidemment pas épargnée :
émeutes en Algérie en 1945 et à Madagascar en 1947 (très lourdement
réprimées par l’armée dans les deux cas), longue guerre en Indochine,
revendications nationalistes au Maroc. A-t-on bien pris la mesure, dans
les milieux politiques et militaires, de cet enjeu ?
Le
message de Gaston Monnerville – d’origine guyanaise, tout comme Félix
Eboué – devant l’Assemblée consultative le 25 mai 1945 est sans
ambiguïté : « Grâce à son Empire, la France est un pays
vainqueur ». Un Empire qui a représenté sous l’Occupation un
véritable enjeu militaire, mais aussi idéologique entre Vichy et la
France Libre. Si Pétain refuse de partir hors de France, c’est aussi
parce que son régime défend « l’unité nationale, c’est-à-dire
l’étroite union de la métropole et de la France d’outre-mer ». Les
mêmes thèmes sont alors développés à Londres et « que l’Empire
reste la possession de la France » est l’une des préoccupations
majeures du général de Gaulle. Symboliquement d’ailleurs, après
l’entrée en résistance de Tahiti, des comptoirs indiens et de la
Nouvelle-Calédonie (septembre 1940), le gouverneur Félix Eboué
accomplit dès le 26 août 1940 le ralliement du Tchad à la France Libre,
anticipant celui de toute l’AEF et servant de base territoriale au
mouvement gaulliste jusqu’au débarquement anglo-américain. A
partir de 1943, l’Armée d’Afrique commandée par le général de Lattre de
Tassigny réussit l’amalgame d’une « représentation vivante
de tout l’Empire » ; elle s’illustre en Italie, dans la
libération de l’île d’Elbe et lors du débarquement en Provence.
Certes, la Conférence de Brazzaville en 1944 et la Constitution de 1946
apparaissent en rupture – du moins sur les principes – avec tout
un passé colonial. Le préambule de la Constitution est sur ce plan un
modèle du genre, puisqu’il est question d’une « union fondée sur
l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de
religion et que la France entend « conduire les peuples (…)
à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement
leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur
l’arbitraire. ». Pourtant, ces nouvelles institutions, si elles se
font l’expression du nouvel enjeu colonial – celui d’une future
émancipation – ne débouchent sur aucune révision de la conception
traditionnelle de la colonisation « à la française ». Les DOM
et les TOM sont en effet des composantes de la République, laquelle est
(article 1er du titre I) « indivisible, laïque, démocratique et
sociale », ce qui limite singulièrement toute perspective
d’évolution séparée de ces territoires; l’Assemblée de l’Union
Française n’est que consultative et le pouvoir reste aux mains du
Parlement et du gouvernement français. En fait, personne ne veut perdre
ou amputer la nouvelle « Union française », qui se substitue
en fait au vieil Empire, garant de la puissance de la France dans le
monde d’après-guerre. Faut-il remanier, dit en substance M.Viollette en
1947 l’œuvre admirable que la IIIème République a donnée à notre
pays ? Détruire un bel édifice, reprend le député Pierre
July, cimenté par tous les soldats, les missionnaires, les
colons, les héros épiques Gallieni et Lyautey, en bref « la
rayonnante création du génie universel et humain de la
France ? » D’autant que, selon le ministre des colonies,
Marius Moutet, la France, contrairement à l’Australie ou aux
Etats-Unis, n’a pas fait disparaître les populations indigènes !
Derrière les discours rassurants, l’enjeu est bien désormais celui de
la survie de l’Empire, dans un monde où les décolonisations sont
rapides et spectaculaires (les Indes britanniques dès 1947), selon le
principe onusien du « droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes ». De plus, si la guerre froide peut dans une certaine
mesure ralentir certaines évolutions, ni les Etats-Unis ni l’URSS ne
sont prêts à soutenir bien longtemps les vieilles puissances
coloniales. Dans la logique des Blocs, les indépendances deviennent
alors des enjeux essentiels, aussi bien en Asie qu’en Afrique. De toute
évidence, en Indochine, il ne s’agit plus de se battre pour l’héritage
de Jules Ferry mais bien pour arrêter en Asie la pénétration
communiste, pour défendre les valeurs du « monde libre »,
pour disposer de bases solides en cas de conflit généralisé. Quoiqu’il
en soit, les finalités coloniales deviennent de plus en plus floues
dans une IVème République fragile et instable, alors que
l’anticolonialisme gagne partout du terrain. Frantz Fanon publie en
1952 Peau noire et masques blancs, tandis que Sartre définit
dans Les Temps Modernes le colonialisme comme un système
global et raciste de spoliation et d’exploitation. Dans l’édition
d’après-guerre de Tintin au Congo (belge, il est vrai !), le célèbre petit reporter fait d’une
certaine manière son autocritique : il ne glorifie plus dans les
écoles de brousse la « mère patrie », mais se contente
d’apprendre le calcul. Dans Paris-Match, le journaliste
Raymond Cartier actualise habilement de vieilles thèses populistes,
selon la formule célèbre « la Corrèze plutôt que le
Zambèze ». En effet, l’opinion publique comprend mal qu’on
construise en Afrique des lycées modernes tandis que des préfabriqués
tiennent lieu de CEG dans les régions de la métropole.
Le
choc et l’humiliation de Diên Biên Phu le 7 mai 1954 marquent très
certainement un tournant dans l’histoire coloniale ; mais qui en
France s’est vraiment senti concerné par cette guerre lointaine ?
L’année 1954 est plutôt celle d’un lâche soulagement. Pierre Mendès
France incarne – à tort ou à raison – une forme de
modernité politique en matière coloniale, à travers la fin de la guerre
d’Indochine et l’autonomie de la Tunisie, mais il ne peut empêcher une
nouvelle crise, celle de l’Algérie. Le drame algérien, qui se noue en
1954-1956 et se prolonge par une sale guerre jusqu’en 1962, cristallise
à lui seul tous les espoirs et les désillusions de l’aventure coloniale
française depuis 1830. Le discours impérial en est provisoirement
revigoré : peut-on brader un héritage légué par plusieurs
générations ? Faut-il abandonner tant de débouchés pour notre
industrie et notre commerce et ignorer la manne énergétique du
sous-sol algérien ? Faut-il revenir sur le statut de 1947, très
favorable aux Européens ?
En
novembre 1954, F.Mitterrand résume sans conteste l’opinion majoritaire
lorsqu’il affirme en réponse à l’insurrection algérienne que « Des
Flandres au Congo, il y a la loi, une seule nation, un seul
parlement ». Et dans les milieux politiques comme militaires, la
« guerre » à mener n’en est pas une. Il s’agit de maintien de
l’ordre dans des départements français, face à des mouvements de nature
révolutionnaire. L’enjeu n’est donc pas colonial, mais national. Si
Raymond Aron, dans La Tragédie algérienne met en avant des
arguments réalistes, à la fois politiques et économiques, en faveur
d’une inévitable souveraineté algérienne et donc d’une « Autre
France », Jacques Soustelle, gouverneur général de l’Algérie en
1955, dit sans détour que «l’on ne se débarrasse pas à la
sauvette d’une province qui fut française avant Nice et la
Savoie ». L’enjeu républicain de l’indivisibilité du territoire
est pourtant totalement dépassé : face au FLN d’abord, pour qui
l’indépendance est la seule issue possible ; face à l’ONU et
aux grandes puissances ensuite, qui considèrent que la France doit
respecter le droit des peuples à disposer d’eux mêmes ; face à
l’opinion publique enfin, divisée en métropole sur un conflit qui est
aussi celui de ses jeunes conscrits. Au débat succède le déchirement et
la guerre civile, particulièrement dans une Algérie qui devient un
véritable bourbier militaire. La gauche communiste radicalise certes
ses positions, mais n’en vote pas moins en 1956 l’octroi des
« pouvoirs spéciaux » au gouvernement Mollet, tandis que la
droite nationaliste et antiparlementaire connaît à la faveur du conflit
algérien une véritable résurgence. Il ne s’agit alors plus seulement de
la survie de l’Algérie française, mais de la survie d’un régime dont on
se plait à critiquer l’impuissance à venir à bout de la
« rébellion » : la Vème République naît de cette
impuissance coloniale.
.jpg)
Mitterrand en 1954 : l'Algérie c'est la France.
La fin dramatique de la guerre
d’Algérie (1958-1962) occulte en fait la relative réussite de la
décolonisation africaine. En 1958, la France offre aux Africains et aux
Malgaches le choix entre une libre association dans le cadre de la
Communauté française et la sécession : seule la Guinée de Sékou
Touré vote non au référendum constitutionnel. En parallèle, certains
territoires (la plupart non africains) choisissent de rester des TOM et
de ne pas s’intégrer à la Communauté (la côte des Somalis, les Comores,
la Nouvelle Calédonie, la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon). La
Communauté devient vite un cadre trop étroit pour les Etats membres,
qui aspirent à une pleine indépendance, tel le Sénégal de L. Sédar
Senghor. Le premier état à réclamer son indépendance est le Mali, qui
lui est accordée solennellement – avec celle de Madagascar – en juin
1960. A la fin de l’année 1960, tous les pays d’Afrique noire
obtiennent leur indépendance et sont admis à l’ONU.
L’indépendance algérienne ne passe par les mêmes voies de la
négociation pacifique. L'ambiguïté du discours gaulliste - le
« Vive l’Algérie française ! » n’a été prononcé qu’une
seule fois à Mostaganem, mais probablement une fois de trop - contribue
à attiser les divisions des Français. C'est une nouvelle guerre
franco-française qui se dessine, qui ne manque pas de rappeler
l’Affaire Dreyfus : défense des droits de l'homme et de la
justice, d'un côté; défense de l'armée et de la raison d'État au nom de
la nation, de l'autre. Les catholiques sont divisés et la revue Témoignage
chrétien joue
par exemple un rôle important dans la dénonciation de la torture et de
la guerre. Autre symbole fort de ce déchirement en deux camps opposés,
les intellectuels s'engagent par les formes traditionnelles de leur
combat, à travers les pétitions et les articles de presse : en
septembre 1960, la pétition dite « des 121 » (Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Pierre Boulez, François
Truffaut, Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwartz, Simone Signoret, Yves
Montand etc.) proclame le droit à l'insoumission et donc le droit à la
désertion pour les soldats. Une contre pétition d'intellectuels,
parmi lesquels Roland Dorgelès, Jules Romains, Roger Nimier, favorables
à l'Algérie française, dénonce « une minorité de rebelles,
fanatiques, terroristes et racistes [...] armés et soutenus
financièrement par l'étranger ". Le PCF se prononce bien sûr pour
l’« arrêt de la guerre », mais il a une attitude relativement
peu offensive et se voit dépossédé des principales initiatives au
profit d'autres mouvements, comme l'Union nationale des étudiants de
France (UNEF) ou encore le jeune Parti socialiste unifié (PSU), créé en
1960 comme un « groupe d’action pour la paix en
Algérie »..
Arès
les tergiversations de l’année 1958, la perspective proposée par de
Gaulle en septembre 1959 est celle de l'autodétermination: les
Algériens ont à choisir entre la francisation, la sécession et une
forme d'autonomie interne dans le cadre de l'Union française.
Parallèle- ment, il se montre ferme face aux Français d'Algérie qui
défient le pouvoir, comme lors de la semaine des barricades,
insurrection déclenchée par des activistes d'Alger en janvier 1960,
puis au moment du putsch commandé par quatre généraux, Challe, Jouhaud,
Salan et Zeller, en avril 1961. Les soldats du contingent jouent un
rôle décisif dans l'échec du coup d'État, en refusant d'obéir aux
ordres des officiers putschistes. De Gaulle fait alors usage de
l'article 16 de la Constitution et s'empare des pouvoirs spéciaux, non
sans utiliser habilement le pouvoir de la télévision sur les masses.

Le général de Gaulle en habit militaire s'adresse aux Français en 1961
Les
dernières années du conflit sont marquées par des tragédies dont les
victimes viennent s'ajouter à tous les morts de la guerre (24 000 parmi
les soldats français et 234 000 parmi les combattants indépendantistes
et la population algérienne, selon l'estimation de Ch-R. Ageron). À
partir de 1960, l'Organisation de l'armée secrète (OAS), groupe dont
les membres luttent pour la préservation de l'Algérie française, se met
à perpétrer des attentats terroristes en Algérie et en métropole. Le 17
octobre 1961, à Paris, des Algériens manifestent pacifiquement, à
l'appel du FLN: un certain nombre de manifestants tombe sous les coups
de la police parisienne. Le 8 février 1962, c’est le drame de Charonne
lors d’une manifestation anti-OAS, neuf personnes (presque toutes
communistes) périssent étouffées ou écrasées lors de l'assaut de la
police à la station de métro du même nom. Le 18 mars 1962, le
cessez-le-feu est proclamé et lors du référendum organisé le 8 avril,
plus de 90 % des électeurs approuvent les accords d'Évian qui confèrent
à l'Algérie son indépendance. Près d’un million de
« pieds-noirs » sont rapatriés d’Algérie, dans des conditions
parfois difficiles. La plupart s’installent dans le Midi et en Corse,
non sans la nostalgie d’une époque révolue. Parmi ces rapatriés
figurent environ 20000 « harkis » ou supplétifs musulmans de
l’armée française, indésirables dans leur pays d’origine et peu
considérés dans leur pays d’accueil.
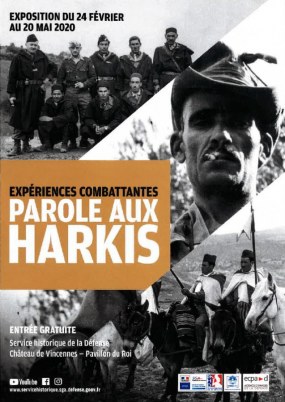
Les harkis, supplétifs de l'armée française et oubliés de la République (exposition 2020 du SHD de Vincennes qui fut prolongée jusqu'au 17 juillet)
La
fin de l’Empire colonial africain entre 1958 et 1962 n’a pas provoqué
l’effondrement redouté, ni en France ni dans les anciennes possessions
françaises. Au fond, le pays en revient – dans un contexte
démographique et économique bien plus favorable qu’au XIXème siècle – à
consacrer l’essentiel de ses forces à son expansion intérieure, dans le
nouveau cadre du Marché Commun. La « plus grande France »
prend la forme de la modernité urbaine et industrielle et c’est alors
le « Concorde » ou le « France » qui font rêver à
de nouveaux espaces.
Faut-il alors rappeler en conclusion l’une des
célèbres apostrophes de Clemenceau à Ferry dans le débat crucial qui
s’est joué à la Chambre dans les années 1880 : « Vous
êtes en face d’un pays où se dressent les problèmes les plus graves
pour une nation. Et vous trouvez qu’il n’y a pas là un domaine
suffisant pour une ambition humaine et que l’idée d’augmenter la somme
de savoir, de lumière dans notre pays, dé développer le bien-être,
d’accroître la liberté, le droit, d’organiser la lutte contre
l’ignorance, le vice, la misère, d’organiser un meilleur emploi des
forces sociales, vous ne trouvez pas que tout cela puisse suffire à
l’activité d’un homme politique, d’un parti » ?

Le débat Ferry/Clemenceau en 1885 : une autre voie était possible
Clemenceau avait sans doute mesuré dès 1885 la
contradiction fondamentale entre
les principes de la République et l’action coloniale mais il n’avait
pas les moyens d’inverser le cours de l’histoire européenne. Dans un
article de La Dépêche datée du 20 mai 1900, le même Clemenceau était scandalisé par
l'exposition au
Trocadéro de "têtes de nègres coupées", tout en conseillant aux
lecteurs
de se procurer le pamphlet de Paul Vigné d'Octon, dédié au ministre des
colonies, La Gloire du Sabre...