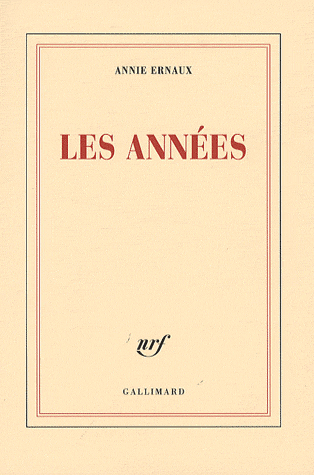| BIENVENUE DANS LES ARCHIVES |
BILLET AVRIL 2009 L'historien du contemporain est toujours à la recherche de sources qui lui permettent d'imaginer ce qu'a pu être l'air du temps, celui d'un monde dont il peut éventuellement se souvenir, mais qui demeure pour lui une friche intellectuelle : un mélange confus de mots, d'odeurs, de sons, d'images, de sensations, en bref tous les "révélateurs" d'une époque. A dire vrai, j'ai déjà acquis un peu d'expérience en la matière à travers ma (modeste) contribution à l'histoire du rock. La découverte "générationnelle" du rock n' roll à la fin des années 60 et au début des années 70, l'écoute en boucle de Revolver des Beatles, puis de Songs from a Room de Cohen et Hunky Dory de Bowie, ont changé ma façon de voir le monde, tout comme je le suppose le monde a changé pour tous ceux qui ont écouté Presley en 1955 ou les Stones en 1965 (Satisfaction) ou beaucoup plus tard Pornography des Cure (1982). A partir de là - et aussi d'un apprentissage d'une culture rock bien plus savante que les cultures mathématiques, littéraires ou même historiques réunies! - en découle la thèse - très simple en apparence - que si les Beatles ont changé le cours de la vie de millions d'adolescents et d'adolescentes, ils ont aussi changé le monde ou du moins l'histoire des société occidentales. Le phénomène est alors tout aussi digne d'intérêt que la guerre froide et les rapports est-ouest, d'autant que dans la chute du communisme, le rock n'a pas eu qu'un rôle accessoire. Heureusement, j'ai été accompagné dans cette analyse par quelques grosses pointures qui ont tenu à peu près le même discours, ainsi Jon Savage, Salman Rushdie, Vaclav Havel... Un livre m'a, ces derniers temps, fait un peu plus réfléchir sur la construction du discours historique et la façon dont nos cheminements personnels participent à la construction de ce discours et donc à l'histoire elle même.
Le livre est celui d'Annie Ernaux, Les années (sorti en 2008, mais lu seulement le mois dernier). Dans ce roman, Annie Ernaux condense soixante ans de vie française, de l’Occupation jusqu’à l’élection présidentielle de 2007 (le couple « Sarko-Ségo »), soit plus d'un demi-siècle articulé autour de quelques photos ou de films d'archives personnels, de souvenirs communs reconstitués avec une précision de sociologue/ethnologue des biens matériels (du transistor à l'I-Pod). C'est un « je me souviens » distancié (le « elle » de la narratrice), aux antipodes de l’autofiction ou de l’autobiographie complaisante (autobiographie « romanesque » préfère l’auteure), influencé autant par Pérec (Les Choses, Je me souviens etc) que par Bourdieu (le déterminisme social) et aussi Ricoeur (le temps, la mémoire, le récit). Pour le reste, j'avoue mal connaître l'oeuvre d'Annie Ernaux mais je vais rattraper mon retard, car rien que le projet élaboré dans L'usage de la photographie me paraît passionnant. Quant aux années, voilà le point de vue de la narratrice : «Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu’on l’entend généralement, visant à la mise en récit d’une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde, saisir le changement des idées, des croyances et de la sensibilité, la transformation des personnes et du sujet.» Tout est dit et le résultat est époustouflant de vérité : je n'ai jamais rien lu d'aussi pénétrant dans les ouvrages d'histoire culturelle et sociale, même si toute comparaison des genres est évidemment discutable. Dans Les années, chaque décennie est finement étudiée et caractérisée, à l'aide de quelques formules qui font mouche et qui résument toute l'époque. Ainsi dans les années 60 "Le discours du plaisir gagnait tout. Il fallait jouir en lisant, écrivant, prenant son bain, déféquant. C'était la finalité des activités humaines". On ne sent ni mépris ni condescendance amusée pour les périodes qui apparaissent déjà "vieillies" (mot paradoxal puisque il s'agit de la jeunesse de l'auteur dans l'austérité des années 40-50, où l'on ne jette rien et où tout respire encore l'avant-guerre, y compris la sexualité bridée). Pas plus de rejet des époques qui plongent dans une post-modernité sans repères, où l'on jette tout, et où l'on zappe en permanence dans une atmosphère de jeunisme débridé). Les années se situent sur un terrain très différent de celui creusé (par exemple) par François Cusset dans sa brillante analyse d'une décennie, à savoir les "cauchemardesques" années 80. En effet, les eighties d'Annie Ernaux, passée la franche déception de l'après mai-1981, relèvent de la même implacable logique que pour les autres années du temps qui passe. Tout se construit et se déconstruit autour du langage et de ses évolutions : compétitivité, précarité, employabilité, flexibilité, ce sont ainsi les maîtres mot des (sinistres?) années 80. Les années 2000 valent-elles beaucoup mieux ? Au bout du compte, ce sont peut-être les années 70 qui apparaissent sans les idéaliser comme les plus heureuses, encore porteuses d'un bonheur à venir, celui des utopies post-68. C’est particulièrement vrai entre 1974 et 1978, les années Larzac, Charlie-Hebdo et Actuel, dans la société libérale avancée du sémillant Giscard (et soit dit en passant, bien des choses ont effectivement changé en 1974-75 !). Annie Ernaux était professeure, moi j’étais au lycée, pas dans un très bon lycée d’ailleurs selon les critères d’aujourd’hui, mais on s’en fichait bien. En seconde lors de l’élection de Giscard, notre professeur d’histoire, un militant du PSU (Bernard Ravenel) nous faisait voter, tout en nous racontant avec plein de diapos le Chili d'Allende et la Révolution des oeillets. Il avait d'ailleurs déchanté : notre classe de bons élèves matheux avait voté Giscard, de peu ! En fait, on votait tout le temps dans son cours, notamment pour savoir sur quoi on allait discuter (et voter) durant l'heure prochaine et de fait il n’y avait pas de cours (sauf un jour d’inspection, peut-être). Comme on parlait beaucoup des sujets qui fâchent - la révolution, le nucléaire, l’écologie, Lip – j’avais été convoqué en tant que délégué de classe par la proviseure-adjointe. Elle voulait savoir ce qui se tramait dans les cours de Bernard Ravenel : faisait-il le programme ? De quoi nous parlait-il ? Avec zèle, je lui décrivais des heures de cours qui ressemblaient comme deux gouttes d’eau au contenu du Mallet-Isaac et elle paraissait dubitative, puis je racontais tout cela à Ravenel qui se marrait bien. Au printemps, direction les pelouses, avec les guitares, les cheveux longs des garçons et les tuniques indiennes des filles et vue imprenable sur le périphérique parisien. Chanson : « Comme un arbre dans la ville »(tiens, j’ai retrouvé cette jolie chanson de Maxime Le Forestier dans Mes Années). Cours d’aujourd’hui : la pollution automobile !
On entrait vraiment dans le monde des adultes.
|