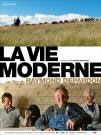billet de mars 2010

Farrebique de G.Rouquier (1946)
Le Salon de l'agriculture à Paris s'ouvre dans une ambiance morose voire sinistre en ce début mars, sur fond de profonde crise agricole (lait, fruits et légumes, céréales : la « plus grave depuis trente ans » selon le ministre de l'agriculture). Le président de la République en snobe l'ouverture, craignant peut-être des réactions trop hostiles. On voit mal en effet Nicolas Sarkozy se faire le chantre de la "ruralité" comme son prédécesseur. Question de style, de culture, de racines...
Les commentateurs aujourd'hui pronostiquent la disparition des « paysans », ainsi dans Marianne du mois dernier (No 669) cette belle « Chronique de la mort annoncée d'un paysan français », narrant les graves difficultés d'un producteur de fruits provençal, lequel dénonce pêle-mêle les centrales d'achat, les grossistes, les directives européennes, les écologistes irresponsables, tandis que les producteurs de fruits et légumes pourraient devoir rembourser les aides versées par l’Etat entre 1992 et 2002, à la demande de Bruxelles.
Le problème est complexe et renvoie justement à ce que le sociologue Henri Mendras constatait déjà en 1967 dans La fin des paysans (le terme, curieusement, revient à la mode au XXIème siècle!) : la fin d’une vieille civilisation, où les paysans tenaient une place centrale. « Dépossédée par la grande industrie de la production des intrants, exclue des chaînes de transformation et d’échange des productions végétales et animales, asservie aux contraintes du marché, la société paysanne occidentale vit les derniers jours d’une civilisation agraire millénaire » écrivait alors Mendras en pleine révolution productiviste, celle-là même qui a dévasté - entre autres - le sol breton, détruit les bocages, arrosé les terres de produits « phytosanitaires » hautement cancérigènes et envoyé des millions de paysans dans les belles villes modernes. En 1964, Jean Ferrat exprimait cette nostalgie du « monde ancien » avec une jolie veine poétique qui ne renvoie pas à Mistral ou à Barrès mais plutôt à celle des communautés montagnardes rétives à l'autorité et finalement vaincues par la société moderne (capitaliste ?) :
Ils quittent un à un le pays
Pour s'en aller gagner leur vie
Loin de la terre où ils sont nés...
Or, ce monde ancien ne s’est pas effacé en un ou deux siècles d’industrialisation, mais en une ou deux décennies de modernisation accélérée (de 1947 à 1967, pour faire court). En 1945, les paysans représentent près de 30% de la population active, en 1975, ils ne sont plus que 10% ; en 1995, c’est à peine 5% et de nos jours un peu moins de 3,5%. Pendant le même temps, la production et les rendements progressent, la taille des exploitations double, les paysans ont un mode de vie qui les rapproche de plus en plus de celui de la grande ville et la France s’affirme comme la première puissance agricole de l’Union européenne avec près de 20% du produit agricole des « 27 ».
La pertinence des analyses de Henry Mendras n’est plus remise en cause, mais le mythe paysan n’est pas tout à fait mort, loin de là, à tel point qu'il renaît maintenant sous des formes inédites (le paysan jardinier des paysages, conservateur des traditions, militant anti-mondialisation etc.) et qu'il finit en 2010 par éclipser le très technocratique « agriculteur ». Attention toutefois aux erreurs de perspectives : l’ouvrage de H.Mendras ne comportait pas en 1967 dans son titre de point d’interrogation : c'était bien la fin des paysans. L’historien doit replacer cette fin dans son vrai contexte – les années 1960 – et en l’inscrivant dans la plus longue durée, à savoir un siècle d’histoire rurale.
En effet, le constat d’une fin des paysans a quelque chose de provocateur, dans les années 1960 comme dans les années 2000. On le sait bien, l’exode rural, l’attrait de la civilisation urbaine, la modernisation des campagnes ne datent pas seulement de l’après-1945, en dépit d’un « retard français » qu’on s’est plu à commenter et surtout à stigmatiser. Ce qui change dans les années 1960/70, par rapport aux époques antérieures, c’est que la nostalgie n’a plus d’avenir, juste une ritournelle, pour se souvenir un peu d’un passé parfois idéalisé. Si quelques néo-ruraux tentent l’aventure des campagnes dans les années 1970, si les résidences secondaires, les espaces touristiques revitalisent provisoirement le tissu rural, on ne sent poindre aucun sentiment de regret d’un âge d’or paysan, où la terre ne mentait pas, pour reprendre le discours pétainiste (mais Pétain est au fond l’héritier de Méline et de Barrès) mais où l’on mentait sur les réalités du métier – quoi de plus dur que le travail paysan ? Les films de Pagnol des années 30 et 40 ont réactivé non sans talent le mythe moderne de la terre, mais sous la forme d’un mythe populaire aimablement « pagnolesque » ; leurs versions modernisées des années 1980/90 (signées Claude Berry) sont de beaux chromos passéistes qui ne font plus guère fantasmer les spectateurs citadins. En 1946, le film documentaire de G.Rouquier, Farrebique, est un petit chef d'oeuvre mais reste imprégné de poésie lyrique et pastorale, sous des dehors naturalistes. En 1967, Alexandre le Bienheureux, avec Philippe Noiret, fait sourire et gentiment rêver d’un monde rural comme arrêté, mais fait-il vraiment regretter le temps passé, ce monde « qui disparaît » ?
Examinons un peu le mot « paysan » et ses avatars. Il renvoie à une réalité sociale quasi féodale (paysan/seigneur), mais le terme est encore employé jusqu’aux années 1950, de la même façon que « ouvriers » ou « employés ». On ne parle pas de « ruraux » et assez peu encore d’agriculteurs. Tout au plus fait-on la distinction entre le paysan propriétaire (même petit, qui cultive sa terre ou traie ses vaches) et le fermier/métayer qui loue la terre (mais il est tout de même un paysan) et surtout avec l’ouvrier agricole et le domestique, qui relèvent d’un sous-prolétariat rural peu considéré (mais « paysan » par nature). Toute la littérature « rurale » sinon ruraliste, qu’elle soit littéraire, politique, syndicale, géographique, cinématographique, se satisfait du mot « paysan », qu’emploie encore volontiers un Michel Debatisse (syndicaliste puissant aujourd'hui bien oublié) dans les années 1960.
On peut distinguer trois types de représentations du paysan depuis le 19ème siècle qui vont alimenter peu ou prou le mythe paysan.
1. Les paysans par eux-mêmes, un genre qui se développe au 19ème siècle et surtout au 20ème siècle grâce à quelques autobiographies et récits de vie. Les exemples sont assez nombreux (E.Guillaumin, E.Grenadou), assez pour constituer une sensible mémoire paysanne. On peut associer à ce genre un récit comme celui d’Emilie Carle, institutrice dans la montagne briançonnaise ou celui de P.J Heliaz, qui décrit son enfance dans le milieu d’ouvriers agricoles en Bretagne. S’il est illusoire de construire une histoire des paysans avec ces seuls témoignages, nul doute que cela permet de ne pas s’en tenir aux seules statistiques et aux généralités. On peut y associer certaines chansons paysannes, des contes aussi, où il est question des misères et des peurs (loups, chiens, incendies), les superstitions, les sorciers et sorcières (encore en 1963 un briquetier rural des Ardennes assassina un sorcier qu’il suspectait d’avoir jeté un sort sur ses fours !).
2. Les représentations que l’on se fait des paysans, notamment dans le milieu urbain mais aussi dans la presse, la littérature, le cinéma, les affiches, la publicité, la radio et la télévision. Les exemples sont évidemment très nombreux et on ne peut ici en faire la synthèse. La littérature reste d’une aide précieuse, surtout celle du 19ème siècle. Dans La Terre, Zola se veut naturaliste et il dresse un portrait sans complaisance du monde paysan, brutal, grossier, âpre au gain. On est en réalité un peu dans le même monde des « peaux-rouges » de Balzac dans Les paysans. Dans ces deux ouvrages, les romanciers donnent une vision extrêmement sombre du monde rural : brutalité, violence, âpreté au gain, dévergondage précoce. Chez Balzac, des paysans tuent un garde forestier pour intimider leur propriétaire qu’ils réussissent à chasser et chez Zola, des enfants tuent leur père après qu’il leur a fait donation de sa terre ! La violence paysanne relève en partie du darwinisme social. A l’inverse, Giono chante la terre, une Provence certes moins idyllique que celle de Pagnol, mais c’est une terre de la renaissance. Delteil, d'origine paysanne (pauvre) fréquente le Tout Paris des années folles pour (re)devenir un écrivain-paysan au milieu des vignes languedociennes.
Quoi qu’il en soit, l'historien E.Weber (La fin des terroirs) a bien montré que l’image triviale du paysan (bouseux abruti, mal fagoté, miséreux) est bien ancrée dans les villes dès le milieu du 19ème siècle et les paysans tendent à souffrir d’un complexe d’infériorité (Il faut dire que certaines pratiques (la vente des cheveux des femmes, par exemple) ne fait rien pour redorer le blason paysan). Une vision qui a perduré au siècle suivant.
3. Les études « scientifiques » sur le monde paysans se sont multipliées au XXème siècle, avec l'essor des sciences humaines et sociales
- Les études géographiques, assez nombreuses, certaines ayant marqué leur époque (Gravier, Demangeon, Bonnamour), à travers la travers l’étude de l’espace rural, du paysage rural (et agraire), de l’exode rural etc. En 1905, A.Demangeon soutient une thèse pionnière sur la Picardie.
- Les études sociologiques, qui vont des enquêtes sociales, des « visites » aux paysans aux études de la sociologie moderne (Mendras, G.Wright). Ainsi G.Wright étudie t-il notamment le village d’Epagny dans le Soissonnais.
- Les études historiques (qui croisent parfois la sociologie, ainsi chez D.Halévy, G.Wright) : on pense aux grandes thèses d’histoire rurale, au «couronnement » de l’Histoire de la France rurale, parue au Seuil sous la direction du médiéviste G.Duby, lui-même spécialiste de l’histoire des campagnes médiévales. Les années 1960-75 sont d’ailleurs la période faste de l’histoire rurale, dans une sorte de recherche des racines d’un monde qui disparaît. L’un des noms importants de l’histoire rurale contemporaine est Philippe Vigier (sur la propriété foncière) mais on note aussi de nouvelles approches, ainsi les cultures politiques au village (M.Aguhlon), l’histoire des sensibilités rurales (Le Limousin dans la belle thèse d’Alain Corbin, les univers sonores). Depuis quelques années, de nouveaux champs historiques sont apparus, ainsi l’histoire des femmes rurales, l’histoire de la pluriactivité, l’histoire du paysage, mais l’histoire rurale est en net déclin (sauf sur les traces d’Agulhon ou de Corbin et dans le domaine de la micro-histoire). C'est un peu dommage, mais n'est-ce pas le signe que les paysans n'intéressent plus beaucoup les élites intellectuelles.
A partir des années 1950, le mot de « paysan » devient de plus en plus péjoratif (=cul-terreux) et « ringard ». Les comiques s’en amusent (Fernand Raynaud, lui-même de souche auvergnate fait rire avec son « j’suis qu’un pauv’paysan », qui véhicule le cliché du paysan qui se plaint mais qui est en réalité avare et bien plus riche qu'il ne laisse paraître (le célèbre « ça eu payé !»). En 1969, les Charlots brocardent le paysan aviné dans une veine comique parodique (à partir d’une chanson de G.Moustaki, Le Métèque), mais qui en dit long sur l'air du temps (on en rigole grassement) :
Avec ma gueule de pauvre mec
De paysan au profil grec
Qu'aurait eu comme un accident (...)
Le pauvre mec !
Le « paysan-pauvre mec » est donc mal parti au début de l’ère Pompidou, pourtant lui-même aux racines paysannes cantaliennes pas si anciennes. On va lui préférer « agriculteur » (dans les statistiques de l’INSEE), « cultivateur » (le mot préféré des sondages sous la IVème République), viticulteur, maraîcher, exploitant-agricole, éleveur, en bref des dénominations plus économico-statistiques et « modernes ». De plus, le « nouveau paysan » se définit de moins en moins comme une « classe populaire », mais de plus en plus comme une variante rurale des classes moyennes, les plus aisés devenant des notables et/ou des entrepreneurs. On voit dans les années 1970 les « paysans » partir au sports d’hiver ou au « Club Med », ce qui a de quoi intriguer les anciennes générations. En 1947, un sondage montre que 68% des paysans se reconnaissent, non dans une « classe pauvre », mais une « classe moyenne », certes à divers niveaux de richesse, mais l’évolution des mentalités est décisive. Il faudrait aussi faire une place au féminin dans la galerie des stéréotypes. Les « paysannes » sont nombreuses, mal connues, souvent dans l’ombre de leur mari. Beaucoup sont des salariées agricoles, mais on trouve aussi des chefs d’exploitation (elles représentent déjà 13% de cette catégorie en 1926). Nul doute que la « paysanne », souvent représentée sur les peintures, les photographies des cartes-postales est un maillon essentiel de l’économie rurale, et cela depuis le 19ème siècle.
Pourtant si le terme de « paysan » n’a guère survécu à l’évolution de la langue technocratique, il est réapparu paré de toutes les vertus morales depuis une quinzaine d’années, au fur et à mesure de son déclin démographique et sociologique. Finies les caricatures grossières, comme celle de Louis de Funès en paysan dans le film (débile) La soupe aux choux (1981). Les cinéastes nous dressent le portrait intimiste d'un monde qui paraît à l'agonie mais qui porte certaines valeurs d'authenticité : les paysans cévenols de Raymond Depardon dans La vie moderne (2008), ceux de l'Aveyron filmés 40 ans après Farrebique par Rouquier dans Biquefarre (1983).
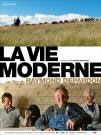
On entend au début du XXIème siècle Jacques Chirac, alors président de la République, mais aussi ancien député de la Corrèze et défenseur affiché du monde rural, affirmer que « nous sommes tous des paysans », ce qui pourrait tout aussi bien signifier que nous ne somme plus du tout des paysans, mais des descendants de paysans ! Et voici Chirac en septembre 1999, dans un discours aux accents quasi méliniens/barrésiens : La ruralité correspond à une aspiration profonde de notre peuple. Pas seulement parce qu'il y trouve ses racines. La ruralité n'est pas une nostalgie ; elle n'est pas une valeur du passé inadaptée à notre époque. Elle est d'abord une éthique : l'homme ne vit pas sans la terre ; il vit avec la terre et se nourrit de la terre. La culture humaine et la culture de la terre sont en réalité indissociables. Nous sommes tous des paysans, au sens éthique du terme. L'éthique paysanne est le lien entre le passé, nos racines et notre histoire... Il n'y a pas de pays sans paysans.»
Mais les paysans ont en fait bien résisté : ils se sont même adaptés de façon remarquable aux transformations du pays. Du moins jusqu’à ces dernières années.
De nombreuses secousses ont ébranlé le monde paysan de 1870 à 1970 sans jamais le faire disparaître : crises économiques, surproductions (vin, céréales, fruits), parasites, calamités climatiques, désastres des guerres (surtout 14-18, grande saignée des campagnes, mais aussi en 1940, sous-estimée : 80 000 paysans tués et 700 000 agriculteurs prisonniers), malthusianisme démographique et exode rural, remembrement rural, productivisme et agro-business et plus récemment effets très contrastés de la politique agricole commune et des quotas...
Le rêve d'une France épargnée des marées par ses digues paysannes a bercé d'illusions le premier XXe siècle, jusqu’à Vichy. Au recensement de 1936, le pays était devenu cette « île heureuse » dans un monde bouleversé par l'industrialisation et l'urbanisation : 32 % des Françaises et des Français travaillaient dans l'agriculture, 34 % dans l'industrie, 34 % dans les services. Sur une population totale de 41 millions d'habitants, 48 % vivaient à la campagne. Cette France paysanne protégée par la ligne Maginot puis exaltée par le maréchal Pétain une fois la ligne franchie semblait bien éternelle. L'exode rural avait été ralenti, mais, en 1958 encore, au lendemain de la signature du traité de Rome qui créait le Marché commun, l'agriculture française était incapable de nourrir la France, le taux de couverture des importations par les exportations n'étant que de 47 % ! Un record de sous-productivité peu banal.
Au fond après plus d’un siècle de résistances plus ou moins fortes et de poussées protectionnistes et agrariennes, le « paysan » s'est adapté à la modernité libérale, ce qui signifie pour lui (ou du moins l’archétype social qu’il incarne depuis les temps médiévaux) sa quasi disparition. Les lois Debré et Pisani (5 août 1960 et 8 août 1962) donnent le signal du grand chambardement. Elles partent aussi d’un constat sans appel : en 1958 encore, au lendemain de la signature du traité de Rome, l'agriculture française est incapable de nourrir la France, le taux de couverture des importations par les exportations n'étant que de 47 % ! Mobilité, concentration, recours au crédit sont les trois axes d’une politique visant à faire entrer l’agriculture française dans le XXème siècle, tout en réaménageant le territoire français. « Aménager le territoire, c'est prendre conscience de l'espace français comme richesse et comme devoir » déclare en 1956, Edgar Pisani, qui devient dans les années 1960 l’un des ministres de l’Agriculture les plus « modernisateurs » du siècle. L’élevage intensif devient l’arme du développement, de nouvelles cultures et méthodes sont introduites, les rendements à l’hectare doublent ou triplent selon les secteurs d’activité, la mécanisation est très spectaculaire. L’agriculture devient dans les années 60-70 capitalistique, avec une course effrénée à la productivité, en liaison avec la puissante industrie agro-alimentaire (20% de la population active, avec BSN, Béghin-Say, Nestlé , Besnier etc) et qui fait désormais…la pluie et le beau temps !
Un demi-siècle après le plan Pisani, la France agricole (mais aussi toute l’Europe verte) connaît la plus grave crise de l’après-guerre, avec une baisse des revenus qui met dans le rouge des dizaine de milliers d’entrepreneurs (= le mot pour paysan moderne), particulièrement dans le secteur de l’élevage laitier. Les cours apparaissent très volatiles, les écarts de prix entre les producteurs et les distributeurs de plus en plus excessifs, tandis que les charges fixes augmentent (coût de l’énergie notamment) et que les subventions européennes ne suffisent plus à combler les déficits. Alors que les paysans ne représentent plus une force électorale déterminante, les hommes politiques en comprennent la valeur symbolique (leur mort c’est celle de la France) et retrouvent le chemin de la terre et de leurs racines. On va donc voir au Salon de l’Agriculture Jean-Pierre Raffarin, le fils d’un cultivateur poitevin, Martine Aubry, la fille du Corrézien (mais pas paysan !) Jacques Delors, François Bayrou le Gascon, fils d’agriculteur et photographié sur son tracteur, François Fillon, qui rappellera ses origines sarthoises à défaut d’être tout à fait paysannes etc. Il va sûrement être question de « plans d’urgence» susceptibles de redonner de la compétitivité à un secteur en perte de vitesse, en misant notamment sur la recherche et l’innovation (thème du Salon). Mais il est clair qu’en 2010 on ne peut se satisfaire d’une simple réorganisation des marchés internationaux. Il s’agit de renoncer à pratiquer l’agriculture telle que nous la connaissons aujourd’hui – et qui mène à des catastrophes financières comme sanitaires - pour développer une agriculture durable (et non « raisonnée ») en France comme dans toute l’Europe communautaire. De ce point de vue les orientations du RAD ou de la branche développement durable de l’INRA apparaissent comme des solutions viables à moyen terme.
|